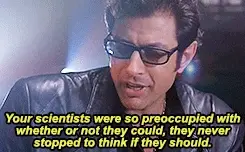Introduction
J’ai eu la chance d’assister à une table ronde sur l’évolution du cadre légal autour de la fin de vie en France. En effet, suite à l’avis d’un conseil citoyen, la réalité du suicide médicalement assisté et l’euthanasie s’approche à grands pas de notre hexagone. Bien entendu, beaucoup de soignants sont directement impliqués dans la discussion de bioéthique qui doit se tenir. C’est un changement de paradigme : comment réunir sous une même blouse des soins pour la vie et des actes pour la mort ?
Le service de soins palliatifs du CHU de Rouen a donc organisé une discussion, conviant plusieurs médecins, psychologues et assistants sociaux à discuter et échanger dans un amphithéâtre. La séance a duré deux heures, suivie d’une demi-heure de questions et commentaires venus de la salle.
Malheureusement retenu dans le service, j’ai manqué la première heure. Mais j’ai été saisi par ce que j’ai pu entendre. J’ai trouvé ce débat riche, constructif, stimulant même. Voici quelques pensées et idées extraites de mes notes.
Plantons le décor
La discussion civique porte sur l’aide médicale à mourir, à destination des patients capables d’exprimer leur volonté, atteints de pathologies incurables, à pronostic létal à court ou moyen terme.
Décortiquons tout cela :
- Aide médicale à mourir : le fait que quelqu’un puisse demander une intervention médicale afin de provoquer la mort. On distingue :
- Le suicide médicalement assisté : le patient reçoit une substance (injectable ou sous forme de comprimé) qu’il s’administre lui-même et qui va provoquer sa mort
- L’euthanasie : c’est le soignant qui administre la substance, à la demande du patient
- Patients capable d’exprimer leur volonté : il faut donc un patient conscient et disposant de ses pleines capacités de jugement. On exclut par conséquent les patients en état de mort cérébrale, atteints de troubles cognitifs ou de retards mentaux. Ils relèvent d’un autre débat qui n’est pas celui qui nous intéresse aujourd’hui.
- Pathologies incurables à pronostic fatal : Toute maladie qui évoluera à coup sûr vers la mort. On pense bien sûr aux cancers très avancés, résistants aux chimiothérapies, mais on peut y inclure certaines maladies rares et invalidantes (SLA, Chorée de Huntington…) que de nombreux patients vivent comme une lente descente aux enfers
- La question du délai n’est pas bien élucidée… Faut-il fixer ce temps à quelques mois ? Quelques semaines ? Il reste à définir.
Bien sûr, le débat est en cours, et chacun de ces termes peut être précisé pour orienter la décision, élargir ou restreindre l’accès à ces mesures. Toutefois, nous voila maintenant armés de termes communs pour poursuivre ce billet.
Quels points de vue considérer ?
Il y a en fait trois points de vue à considérer quand on envisage une aide médicale à mourir. Le point de vue du soignant, du patient, et de la société qui les encadre.
Je les place dans cet ordre croissant d’importance : soignant < patient < société ; car même s’ils sont tous les trois précieux à considérer, ils ne me semblent pas égaux entre eux.
Le point de vue du soignant
C’est celui qui évolue le plus vite depuis la nuit des temps. Il y a peu, l’IVG et l’IMG étaient impensables, l’homosexualité était une maladie. Un peu plus longtemps auparavant, l’épilepsie était une possession par le diable, les sangsues guérissaient les humeurs.
Je ne veux pas dire que les médecins sont opposés à tout changement, ni que le progrès des mœurs médicales est toujours bon. Je souligne simplement que l’état actuel des pratiques n’est pas un argument solide à opposer aux considérations éthiques d’une médecine en perpétuelle évolution.
Les patients changent, leurs besoins évoluent, les maladies se transforment. Avec eux, les générations de soignants se succèdent et adaptent leur pratique. La vocation de soulager celui qui souffre ne saurait être sourde à la plainte de ce dernier. Si les patients requièrent une évolution des soins, et que l’éthique de notre civilisation accepte un nouveau traitement, les soignants finiront par répondre à ce besoin nouveau.
Le point de vue du patient
C’est lui qui motive la recherche et provoque le changement des mœurs médicales, car c’est pour soulager la souffrance des gens que la médecine existe.
Avec l’allongement de la durée de vie et les progrès thérapeutiques permettant de maintenir toujours plus longtemps en vie, nos patients sont exposés à de nouvelles souffrances. C’est une bonne chose ! Qui oserait prétendre qu’il vaut mieux abandonner les hommes à la maladie plutôt que de tenter de les guérir ?
Mais dans cette médecine toujours plus capable, où le patient peut exprimer ses désirs et ses espoirs, de nouveaux besoins apparaissent. De nouvelles questions se posent. Des actes médicaux qui sont techniquement possibles, mais dont l’éthique est incertaine, sont envisagés.
De plus, le rapport médecin / patient a changé. À une médecine paternaliste où le médecin ordonne, succède une médecine où soignant et patient collaborent. Même si cette relation est parfois sous-tendue de frustration et de difficulté de communication, cette évolution est saine. Chacun a le droit (et m’est avis, le devoir) de se saisir de sa santé et d’en être le principal acteur.
C’est maintenant à la société de tracer le cadre, tant légal que moral, dans lequel la médecine peut s’exercer.
Le point de vue de la société
On reconnaît la valeur d’un peuple à la façon de traiter ses animaux Ghandi
J’ajouterais qu’on reconnaît la grandeur d’une nation à la façon dont elle traite ses plus faibles, incluant donc les malades, personnes âgées et enfants.
Si une société œuvre pour le bien de ses constituants, elle doit trouver l’équilibre entre le bonheur et la liberté de l’individu et la sécurité du nombre.
Ouvrir la porte à la mort médicalement assistée pour répondre au besoin d’un petit nombre d’individus expose tous les autres au risque de dérives des pratiques. Mettre en place de nouveaux modes de soin a un coût économique que tous partagent. Faire du suicide un acte médical transforme le concept même de vie. Pour tout le monde.
On ne peut pas ignorer que le désir de quelques-uns peut bouleverser l’ordre moral et la sécurité de tous.
La liberté des uns s’arrête là où commence celle des autres. En matière de santé, la liberté des autres commence très tôt. La société a son mot à dire dans les soins de l’individu. C’est ensemble que nous devons décider de comment nous traiterons nos mourants.
Réflexions
Du point de vue du soignant
La mort comme soin
“La main qui soigne ne saurait être la main qui tue”
…est l’argument que l’on entend le plus souvent de la part des soignants. Mais qu’est-ce qu’un soin ? Si c’est simplement guérir un malade, alors les soins palliatifs et les vaccins ne sont déjà plus des soins. Si c’est de prévenir ou soulager une souffrance, alors l’aide médicale à mourir pourrait en faire partie.
D’un autre côté, on pratique déjà des soins qui n’en sont pas tout à fait. Certaines chirurgies esthétiques sont certes impressionnantes, mais douteuses dans leur pertinence médicale. Certains médicaments fréquemment employés ont une efficacité minime (au mieux) et restent prescrits. L’homéopathie a enfin cessé d’être remboursée, mais cela ne date que de 20211.
Enfin, la mort médicale ne se limite pas à l’injection létale : il faut y inclure l’information loyale et le conseil au patient et aux familles, ainsi qu’un accompagnement psychologique tout au long de la fin de vie. Si ces gestes sont faits avec attention et bienveillance, quelle différence avec un soin ?
L’abandon de la dernière promesse
Une intervenante disait ceci :
“En soins palliatifs, on ne peut pas faire la promesse de la guérison. La seule promesse que nous faisons à nos patients, c’est celle de les accompagner jusqu’au bout”.
Cette médecin avançait que si elle était inconfortable en réalisant une aide médicale à mourir, et employait son droit de réserve pour adresser son patient à un confrère spécialisé, elle trahissait cette ultime promesse. Elle ressentait cet adressage comme un abandon de son patient. Elle se sentait donc coincée : forcée à pratiquer l’aide médicale à mourir, même dans les situations où elle aurait préféré s’en abstenir.
Une réponse intéressante est venue de la salle. Un autre médecin de soins palliatifs réfutait que, si son patient se cassait une jambe (ce qui arrive quand les cancers atteignent les os, les fragilisant), elle ne se sentait pas l’abandonner en l’adressant à un chirurgien orthopédiste. Pourquoi serait-il différent d’adresser le patient à un confrère qui donnerait la mort ?
Je ne suis pas certain d’être convaincu par cet argument. Après sa chirurgie orthopédique, le patient revient et nous continuons son suivi comme promis. Si je l’adresse pour sa mort, je sais que c’est un adieu sur lequel j’émets des réserves.
D’ailleurs, le médecin référent d’un patient peut avoir de nombreuses raisons de s’opposer à sa demande : a-t-il bien réfléchi ? A-t-il bien compris ? Ne peut on pas lui proposer autre chose pour le moment ? mieux le soulager ?
Si le médecin refuse sa demande au patient, pourront-ils tout de même conserver un dialogue sain et confiant, ou est-ce la rupture de l’alliance thérapeutique et une forme d’abandon médical ?
Le droit de réserve est au cœur de l’application de la mort médicalement assistée. Comment la résoudre ne m’est pas encore bien clair.
Histoire d’un aller et d’un retour
L’accompagnement du patient qui meurt est un voyage que le médecin fait avec son patient. Parfois sur des durées longues mais aussi sur celles plus courtes ; un lien se crée entre soignant et souffrant. Des sentiments très forts naissent parfois lors de ce voyage.
Et quand le patient finit par mourir, le médecin revient seul afin d’accompagner un nouveau patient vers sa mort.
Tous dans la salle de conférence semblaient redouter que l’aide à mourir ne subisse les mêmes dérives que bien d’autres actes. Que dans un souci de rendement et d’efficacité, les patients ne soient traités “à la chaîne”, de façon dépersonnalisée. C’est après tout ce qui se passe dans les maternités et dans certains hôpitaux psychiatriques.
Pourtant, il faudra bien se garder de laisser la médicalisation de la mort la banaliser, l’accélération des décès épuiser nos réserves, ne pas transformer ce lent voyage en course poursuite. Sinon, nous perdrons l’humanité de nos médecins, et nos médecins eux-même.
Perspectives sur la création d’un “infirmier de la mort”
De nombreux médecins sont mal à l’aise avec l’idée de participer à une mort médicale. Certains proposent, pour contourner cet inconfort, la création d’un nouveau professionnel de santé qui serait spécialisé dans les soins d’aide à mourir. Ceux-là ne seraient pas médecins, n’auraient pas prêté le serment d’Hypocrate, et n’auraient comme champ d’action que les derniers gestes accompagnant le patient dans son départ.
Pour moi, cela ne fait que décaler le problème.
D’abord, ces soignants2 aussi seront exposés à l’usure d’une répétition de décès, à la souffrance des soins palliatifs, et à la lourdeur de leur geste. Ce n’est pas parce qu’ils ne feraient que ça qu’ils y deviendraient insensibles. Le débat éthique et moral n’est donc en rien facilité par leur présence.
Ensuite, il faudra toujours un médecin pour prescrire le “médicament létal”. Soit ce médecin sera dans l’inconfort de cette prescription, soit (et ce serait pire) il ne se sentirait pas impliqué par celle-ci, et serait détaché de ce qu’elle représente, dépersonnalisé.
Dans ces deux cas, l’existence de ces para-médicaux ne fait que reporter le problème, pas le résoudre.
Du point de vue du patient
La mort médicale : un besoin réel ?
Le comité citoyen a confirmé qu’il s’agissait d’une demande de la population. La question de l’aide médicale à mourir est donc importante à poser. Mais est-ce un vrai besoin ? Un acte qui doit être proposé pour répondre à une souffrance qui ne peut être soulagée autrement ?
On reviendra sur les alternatives déjà en place. Parlons simplement du fait qu’aujourd’hui, nos patients n’obtiennent pas toujours de réponse à leur demande, et voyons pourquoi il est important qu’ils en trouvent.
Le taux de suicides liés à des maladies chroniques augmente, particulièrement dans les populations n’ayant pas accès aux soins (de par leur situation géographique3 ou leur manque de moyens). Que ce soit parce que ces maladies gagnent en prévalence, que la médecine peut prolonger une vie au détriment de sa qualité, ou pour tout autre raison, le résultat est le même. Des gens souffrent de leur maladie et mettent fin à leurs jours pour fuir la souffrance.
On pourrait être tentés de répondre : “Puisque les gens trouvent déjà un moyen de mourir quand ils en ont besoin, pourquoi aurions-nous besoin que l’État et la médecine s’en occupent ?”
Je trouve trois raisons:
- le bien des survivants : Les familles laissées derrière les suicidés doivent vivre dans la douleur et le souvenir de la violence de la mort de leur proche. Quand, au contraire, le décès est accompagné, préparé, paisible, il est beaucoup plus facile et sain pour les familles d’affronter le deuil.
- l’égalité d’accès au soins : si les seuls capables de recevoir une mort digne et paisible sont ceux assez riches pour partir à l’étranger, ou ceux assez chanceux pour obtenir une place en soins palliatifs, que dire à tous les patients laissés pour compte ? Leur nombre va augmenter, la population vieillissant, et le système en place ne peut déjà pas absorber toute la demande.
- la dignité : c’est une notion un peu vague que beaucoup ressortent à bien des sauces. On verra plus loin ce que la notion de dignité implique dans le débat, mais on ne peut pas soutenir sérieusement qu’il est digne d’être poussé à la pendaison par le désespoir de sa maladie et une douleur permanente.
Pour toutes ces raisons, laisser les gens “se débrouiller” par eux même dans leurs derniers instants ne peut pas être la réponse que notre société choisit. Cela va contre toute nos valeurs humaines.
La mort mérite-t-elle d’être vécue ?
Les intervenants remarquaient que les plus prompts à parler de dignité dans la mort sont ceux qui sont bien en vie, pour qui la fin est encore loin. Une fois soulagés de leurs douleurs, une fois accompagnés dans leurs peurs et inquiétudes, les patients qui voient leur vie s’épuiser semblent trouver un confort et une paix dont ils cherchent à profiter jusqu’au bout.
Il n’est d’ailleurs pas rare qu’une personne revienne sur ses directives anticipées4, par exemple en demandant des antibiotiques contre une infection, des perfusions de médicaments, des prises de sang pour évaluer son état… Parfois même certains demandent à être opérés ou intubés dans l’espoir de profiter encore un peu de leurs proches, contrairement à leurs souhaits écrits.
On peut redouter que certains patients, par précipitation et par peur de la mort, ne se saisissent de la mort médicalement assistée sans avoir le temps de traverser les derniers moments agréables qu’ils auraient pu vivre, coupant court à la période souvent apaisante et cruciale qui précède le décès, et dont les familles aussi peuvent profiter.
D’un point de vue sociétal
Que fait-on aujourd’hui ?
Nous avons déjà, en France, une loi encadrant la fin de vie. La loi Claeys-Léonetti (datant de 2016) permet de majorer les thérapeutiques employées au delà de la dose létale afin de soulager un patient en soins palliatifs. Nous avons donc accès à une sédation profonde et à de la morphine à des doses très importantes afin de soulager le patient, et dont l’effet secondaire sera le décès du patient.
La différence avec une aide médicale à mourir est que ces doses ne peuvent être employées que pour le patient qui souffre intensément. Le but du geste n’est pas de provoquer la mort, mais de soulager. On accepte simplement le fait qu’apaiser le patient signifie qu’il va mourir. En attendant que cette souffrance soit telle qu’elle justifie cette décision cruciale, le patient bénéficiera des soins de confort garantissant que ses derniers mois soient aussi paisibles et dignes que possible.
L’aide médicale à mourir consiste au contraire à effectuer un geste (pour l’euthanasie) ou prescrire un traitement (pour le suicide assisté) dont le but est la mort et non le soulagement. Bien sûr, le patient peut trouver un réconfort dans la perspective de la mort ; mais à l’instant où le soignant intervient, le patient n’est pas encore dans un état de souffrance physique critique.
De nombreux soignants rejettent cette évolution. Ils soutiennent que la terrible souffrance qui conduit les patients à réclamer une aide à mourir vient du fait que la loi Leonetti est mal appliquée par manque de moyens. Si nous avions tous accès aux soins palliatifs, que nous puissions soulager convenablement l’anxiété et la douleur en attendant la mort, alors nous n’aurions plus besoin de fuir la maladie et de précipiter la fin. Ces soignants réclament donc plus de place en soins palliatifs, de meilleures formations pour les équipes et une meilleure information pour les patients.
La dignité des uns impacte celle des autres
Qui peut juger de ce qui est digne d’être vécu et de ce qui ne l’est plus ? On pourrait répondre que c’est le patient qui souffre.
Mais deux personnes atteintes de la même maladie, au même stade, ressentant la même douleur, avec les mêmes perspectives d’avenir, sont-elles atteintes dans leur dignité de la même façon ?
Et si l’un choisit de mourir, comment celui qui veut encore vivre un instant de plus doit-il se sentir ?
Vivra-t-il son désir de persister un peu plus longtemps comme de la lâcheté face à la mort ? Ses proches lui en voudront-ils de leur imposer de le voir se dégrader lentement ? Leur semblera-t-il indigne, diminué ? Sera-t-il influencé à choisir la mort médicale alors qu’il n’en ressentait à la base pas le besoin ?
Et que dire de celui qui voudrait partir, mais qui voit les autres patients choisir de survivre encore un peu ? Se sentira-t-il légitime à demander la mort médicale ? Se sentira-t-il coupable ou “faible” de vouloir en finir avec la maladie ?
Il serait ignorant de prétendre que la dignité ne dépend que de celui qui la vit, et stupide de prétendre juger pour un autre de sa dignité dans la maladie. Cette notion si vague mais si fréquemment brandie est bel et bien relative, dépendant du contexte de chacun, mais pourtant influencée par tous. Si nous voulons faire de la dignité un argument dans ce débat public, nous devons d’abord avoir un débat sur ce qu’est la dignité elle-même, et y impliquer nos patients.
Le danger d’une économie
Lorsque l’IMG5 a été rendue légale, on a permis aux parents d’enfants malades de choisir entre mettre un terme à la grossesse ou de la mener à terme. Ce choix sous-entend une promesse : celle que la société fait aux parents qui choisissent de garder leur enfant de les aider à en prendre soin.
L’état n’abandonne pas un enfant né avec une malformation cardiaque ou une trisomie sous prétexte que ses parents n’ont pas les moyens de le soigner : ses pathologies seront prises en charge.
De la même façon, l’aide médicale à mourir ne doit pas condamner les patients qui choisissent de vivre encore un peu plus longtemps à être laissés livrés à eux-mêmes. Si elle devient médicalisée, la mort doit être un choix libre, et non une contrainte financière.
Cela peut sembler évident, formulé ainsi. Pourtant, quand on écoute entre les lignes certains débats politiques, la question des coûts est fondamentale. “On dépense toujours plus, et la population vieillissante aura besoin de toujours de moyens”.
Or, si l’aide médicale à mourir devient une façon d’économiser de ressources en soulageant un patient palliatif, celui-ci subit la responsabilité des coûts que son choix de vivre engendre. Comment être certain que cette pression n’influence pas son choix de vie ou de mort ?
La solution est simple. Il faut investir en parallèle dans les soins palliatifs et dans l’aide à mourir. Si il n’est pas plus “économique” d’orienter les patients vers l’un ou l’autre, ce choix ne subit plus la pression des coûts, les soignants ne sont plus tentés d’orienter les patients, le malade n’est plus stigmatisé. Il ne doit en aucun cas y avoir d’effet vase-communiquant entre les soins palliatifs et l’aide à mourir. Il faut renforcer nos efforts dans l’un et dans l’autre.
-
Oui, j’utilise le mot soignant pour désigner ceux qui donneraient une mort médicale. ↩︎
-
Inégalités en matière de santé : Toutes les régions de France n’ont pas la même densité médicale. Selon où se trouve un patient, il aura plus ou moins de mal à trouver un médecin pour renouveller ses prescriptions, aura plus ou moins d’attente avant de consulter un spécialiste, aura plus ou moins de chances d’obtenir une place en soins palliatifs. L’endroit où vous habitez change drastiquement la qualité des soins dont vous pouvez espérer bénéficier. C’est particulièrement dramatiques dans ces pathologies lourdes où les patients sont, au final, abandonnés. 👉 Source : Cousin, François. « Ressources en soins palliatifs en France : disparités territoriales en 2017 », Santé Publique, vol. 33, no. 2, 2021, pp. 169-175. ↩︎
-
Directives Anticipées : Instructions laissées par une personne expliquant ses souhaits par rapport à la réanimation et les soins invasifs qu’elle pourrait être amenée à recevoir, au cas où elle ne serait plus capable de s’exprimer. Les médecins en tiennent compte dans leur décision de poursuivre ou d’arrêter les soins. Par exemple : doit-on intuber cette personne dans le coma ? ↩︎
-
IMG : interruption médicale de grossesse. Fait de mettre fin à une grossesse à la demande des parents quand cette dernière met en danger la vie de la mère ou quand on détecte chez l’enfant une malformation qui nuirait à sa vie future. Par exemple, détecter un trisomie 21 permet de demander un avortement médical. ↩︎